ÉDITORIAL par Félicité VINCENT Rédactrice en Chef - Une pause dans l’obscène Brest : Entre cynisme géopolitique et calcul stratégique Edito 03 mars 2025

03 mars 2025 - 15:36 - 1486vues
Nous avons une petite faveur à vous demander pour soutenir notre travail Cliquez ici
 À propos de Félicité Amaneyâ Râ VINCENT - Rédactrice en chef à RADIOTAMTAM AFRICA , Félicité s'engage à façonner la radio de demain pour une Afrique prospère, inspirante , et prête à illuminer le monde.
À propos de Félicité Amaneyâ Râ VINCENT - Rédactrice en chef à RADIOTAMTAM AFRICA , Félicité s'engage à façonner la radio de demain pour une Afrique prospère, inspirante , et prête à illuminer le monde.
L’histoire, souvent, ne se répète pas. Mais elle rime. Le 3 mars 1918, à Brest-Litovsk, une Russie révolutionnaire exsangue signait une paix forcée avec les Empires centraux, cédant du territoire pour gagner du temps. Aujourd’hui, c’est un autre Brest, en Bretagne cette fois, qui devient le théâtre d’une proposition de cessez-le-feu en Ukraine, formulée par Emmanuel Macron et Keir Starmer.
Le président français a résumé en des termes diplomatiquement corrects l’essence même du dilemme stratégique : un cessez-le-feu temporaire pour négocier un accord de paix, suivi d’un déploiement de troupes de maintien de la paix. Derrière cette proposition se cache une réalité crue : le temps peut être un atout, mais aussi un piège.
⏳ La paix pour négocier… ou pour repositionner ?
Si l’on suit l’argumentation de Macron, cette pause d’un mois devrait permettre d’établir les bases d’un règlement durable, mais l’histoire nous enseigne que les guerres modernes ne s’interrompent jamais pour de bonnes intentions.
Ce cessez-le-feu, s’il est accepté, sera-t-il utilisé pour négocier une paix viable ou simplement pour permettre aux belligérants de renforcer leurs positions ?
Les trêves dans les conflits contemporains sont rarement un prélude à la paix, mais souvent un répit stratégique :
✔ Pour l’Ukraine, un moyen de consolider ses lignes de défense et de reconstituer ses forces.
✔ Pour la Russie, une opportunité d’asseoir ses gains territoriaux et de mieux préparer la suite des hostilités.
✔ Pour l’Occident, un test grandeur nature d’une possible mission de maintien de la paix, qui, selon la manière dont elle est perçue, pourrait soit pacifier, soit envenimer davantage la situation.
L’ombre de Brest-Litovsk : Quand la paix se paie en territoires
Si la référence à Brest-Litovsk en 1918 semble involontaire, elle n’en demeure pas moins pertinente.
Lénine et Trotsky avaient compris que sauver la révolution passait par un sacrifice territorial temporaire. La question est donc la suivante : qu’est l’Ukraine prête à céder aujourd’hui pour “gagner du temps” ?
Macron et Starmer cherchent-ils à acter la partition du pays, sous couvert d’une trêve humanitaire ?
Le cessez-le-feu proposé ne servirait-il qu’à officialiser les nouvelles lignes de front sous une autre terminologie ?
Et si, comme en 1918, ce qui semble être un gain de temps n’était en réalité qu’un recul définitif ?
Un cessez-le-feu abordable, mais pour qui ?
Macron parle de “cessez-le-feu abordable”, mais ce langage technocratique dissimule une réalité brutale :
Abordable pour qui ? L’Ukraine, qui devra peut-être concéder des territoires sous la pression diplomatique ?
À quel prix ? La reconnaissance de nouveaux rapports de force sur le terrain, légitimant la stratégie de la Russie ?
Quel rôle pour l’Europe ? Un acteur de pacification ou simplement un spectateur d’un ordre déjà réécrit ailleurs ?
Là où Brest-Litovsk a permis à l’URSS de renaître après une perte stratégique, ce cessez-le-feu risque de figer un statu quo favorable aux intérêts russes tout en maintenant l’Ukraine dans une situation de dépendance militaire et économique vis-à-vis de ses alliés occidentaux.
Entre paix forcée et guerre prolongée, quel avenir ?
Nous sommes à un tournant diplomatique : soit cette pause permet une sortie de crise intelligente, soit elle devient une parenthèse cynique dans un conflit qui ne fera que muter.
À Brest en 2024 comme à Brest-Litovsk en 1918, le temps est une monnaie d’échange. La question est de savoir qui l’encaissera réellement.








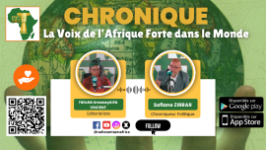











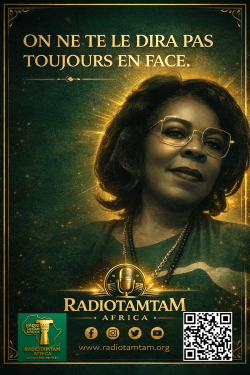















Se connecter Inscription